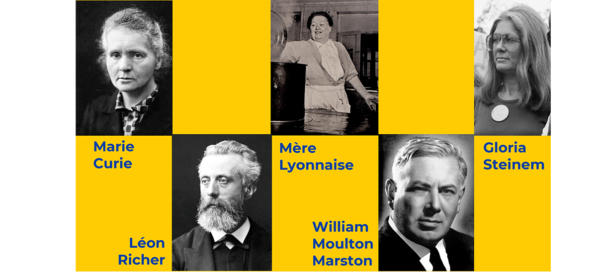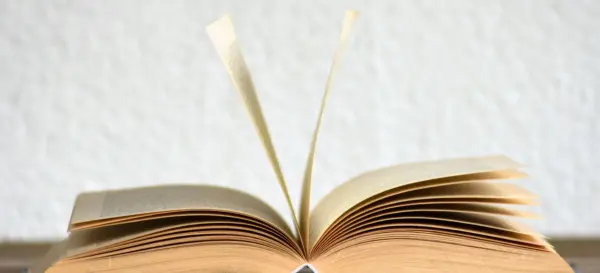Dans les milieux « féminins » aussi, les hommes montent plus vite en hiérarchie
Dans les milieux « féminins » aussi, les hommes montent plus vite en hiérarchie
On a tendance à penser qu’une large partie des inégalités entre les femmes et les hommes tient à la répartition genrée des métiers : en effet, certains secteurs sont fortement à très fortement féminisés (la communication, l’économie sociale et solidaire, le médico-social…) tandis que d’autres sont, en miroir, fortement masculinisés (le bâtiment, la maintenance, la conduite de véhicules, l’armée et la police…).
Dans ce schéma d’analyse, les écarts salariaux s’expliqueraient d’une part par la moindre valorisation de certains secteurs (le « care » paye moins que l’industrie, par exemple) et d’autre part par une moindre verticalité des organisations ne permettant pas aux individus de « monter les échelons » suffisamment (un·e communicant·e a moins de possibilités d’évolution dans son métier et vers d’autres métiers que quelqu’un qui fait carrière dans le « business »).
Mais selon la sociologue Alice Olivier, autrice de Se distinguer des femmes (Éditions de la Documentation française, 2023), cette grille de lecture se heurte à la permanence d’une dynamique de plafond de verre qui fait que même dans les métiers dits « féminins », les hommes ont davantage de chances d’obtenir les postes à responsabilité que les femmes. Les chiffres de l’ESS sont d’ailleurs assez révélateurs : dans ce secteur qui compte 2/3 de femmes pour 1/3 d’hommes, mais seulement 1/3 de femmes parmi ses cadres (CSESS, 2022 – in Rapport AlterNego sur l’égalité pro). Autrement dit, un homme a deux fois plus de chances qu’une femme d’accéder à des postes à responsabilités dans ce secteur !
Mais à quoi cela tient-il ? Alice Olivier pointe du doigt les stéréotypes qui attribuent aux femmes et aux hommes des qualités et compétences différentes. Les hommes qui intègrent des milieux féminisés sont supposés apporter « comme de façon innée, du sang-froid, de la force physique, de l’humour, [on pense] qu’ils ont des sujets de conversation intéressants, qu’ils sont plus techniques, plus rationnels et scientifiques », dit l’autrice dans un entretien au journal Le Monde. Aussi, les femmes accueillent plutôt bien les hommes quand ils arrivent dans « leur » univers. Et d’ajouter que l’effet de rareté leur est favorable : bénéficiant d’une présomption de leadership, les hommes sont validés dans la fonction de responsable, un peu comme si c’était « une réussite » de savoir les attirer et « une chance » de les avoir !
La réciproque est-elle vraie ? La sociologue Haude Rivoal, autrice de l’essai La fabrique des masculinités au travail (La Dispute, 2021) met en évidence que l’insertion des femmes dans des milieux masculinisés ne produit pas d’effet de valorisation des qualités réputées féminines. Soit les femmes sont perçues comme plus fragiles, plus émotives, et cela produit au mieux des réflexes protecteurs chez les hommes, au pire des effets de disqualification ; soit les femmes doivent se conformer à des normes masculines pour faire valoir qu’elles sont « aussi capables qu’un homme » et doivent régulièrement renouveler leurs efforts pour le prouver. Il n’y a donc pas de perception de la « plus-value féminine » quand des femmes intègrent une équipe masculine comme il y a un ressenti de « plus-value masculine » quand ce sont des hommes qui intègrent une équipe féminine.
Autrement dit, quel que soit le milieu, il est statistiquement plus facile pour les hommes de grimper dans la hiérarchie, tandis que cela demande plus d’efforts aux femmes qui doivent, dans les milieux féminisés se distinguer des autres femmes pour entrer en compétition avec des hommes bénéficiant d’une présomption avantageuse ; et dans les milieux masculinisés se battre pour montrer qu’elles valent autant que les hommes.
Comment se sortir de ce double standard qui contribue à perpétuer le plafond de verre ? D’abord en prenant toutes et tous conscience de nos stéréotypes, négatifs ou positifs, de façon à se libérer des croyances limitantes autant que des préjugés. Ensuite, il nous faut interroger en profondeur nos modèles de leadership, de façon à débusquer les traces de masculinité qu’ils comportent encore sous leur apparente neutralité et à identifier les qualités inclusives qui font les grand·es leaders !