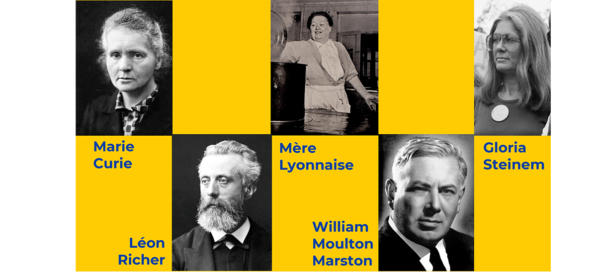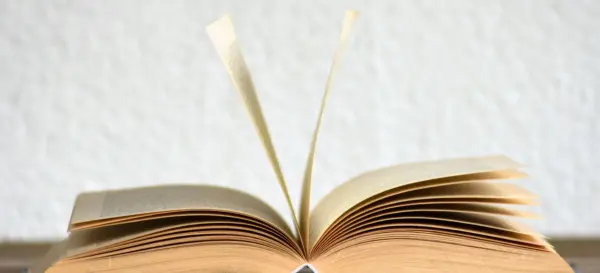Retour sur l’étude Oxfam
La féminisation du pouvoir en France : un plafond de verre toujours bien réel
80 ans après le droit de vote accordé aux femmes, la parité dans les sphères du pouvoir public en France reste largement inachevée. Le premier index de féminisation du pouvoir lancé par Oxfam France révèle ainsi un chiffre sans appel : seulement 28 % des postes clés du pouvoir public et politique sont occupés par des femmes. Alors que comprendre de cette réalité selon les différents niveaux de pouvoir ?
Focus sur l’hexagone
Au sein du gouvernement, la parité progresse mais reste limitée. Si 50 % des ministres sont des femmes, aucun poste régalien n’est occupé par une femme en 2025. Dans les cabinets présidentiel et ministériels, les hommes restent très majoritaires aux postes stratégiques, et la France attend toujours sa première présidente.
Le Parlement, malgré quelques progrès, reflète aussi ces inégalités. L’Assemblée nationale compte 36 % de femmes députées, et les commissions influentes restent dirigées par des hommes.
Le pouvoir local, lui, est encore moins paritaire : seulement 20,8 % de femmes maires, 21,8 % de présidentes de départements, et 29,4 % de présidentes de régions. Les postes de direction dans les cabinets territoriaux sont également aux mains des hommes.
Les autres leviers du pouvoir (préfets, diplomatie, hautes juridictions, agences publiques, partis politiques) restent quant à eux très peu féminisés. Par exemple, 0 % des hautes juridictions sont dirigées par des femmes et seulement 10 % des principaux partis politiques ont une femme à leur tête.
Comprendre les causes et les conséquences
Pour comprendre ce faible niveau de féminisation, c’est du côté de la systémie que le problème se pose : un pouvoir conçu par et pour les hommes, ayant abouti à un univers politique encore aujourd’hui régi par des normes patriarcales. Si la législation, comme la Loi Rixain ou les lois sur la parité de 2000, a permis des avancées notables, elle reste insuffisamment contraignante.
Conséquence directe : on se retrouve face à un imaginaire du pouvoir excluant pour les femmes. Cette absence de rôle model perpétue alors l’autocensure, même dans le secteur privé, et influence les jeunes femmes, qui peinent à se projeter dans ces rôles.
Des bénéfices pourtant bien établis
L’égalité professionnelle et la parité des instances de pouvoir ne relèvent pas seulement de questions éthiques ou de justice. Elles améliorent la performance collective, l’innovation et renforcent la cohésion sociale.
Au-delà des principes de quotas, il est primordial de développer une réelle culture de l’égalité. Car si la parité est une étape essentielle, elle ne saurait suffire à elle seule à bâtir une société véritablement égalitaire. L’enjeu aujourd’hui n’est plus seulement d’intégrer des femmes dans des structures de pouvoir inchangées, mais de repenser en profondeur ces structures elles-mêmes : leurs codes, leurs usages, leurs temporalités, leurs représentations.
L’objectif à terme ? Faire émerger une culture du pouvoir débarrassée des normes masculines qui l’ont historiquement façonnée, dans laquelle les femmes sont pleinement légitimes, visibles, audibles… Et donc en pleine capacité de transformer les règles du jeu.